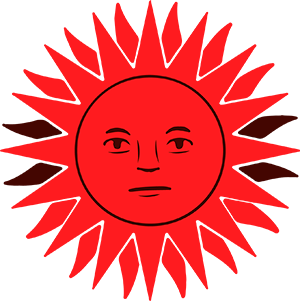Professeur, avocat, syndicaliste, homme politique et journaliste, il fut le fondateur de la Confédération des Travailleurs d’Amérique latine et du Parti populaire socialiste mexicain et s’est distingué dans les débats publics de la période post-révolutionnaire
Par Pedro Rocha Curado e Athos Vieira *
[Traduction du portugais : Aloys Abraham, Emma Tyrou, Félix Gay, Jean-Ganesh Faria Leblanc, Laure Guillot-Farnetti]
LOMBARDO TOLEDANO, Vicente (mexicain; Teziutlán/Mexique, 1894 – Mexico, 1968)
1 – Vie et praxis politique
Vicente Lombardo Toledano est né dans l’État de Puebla, au sein d’une famille de commerçants d’origine italienne. Son père, Vicente Lombardo Carpio, possédait des propriétés et des investissements dans le secteur minier, en plus d’être impliqué en politique, notamment en tant que maire de Teziutlán en 1905. L’enfance et la jeunesse de Lombardo Toledano se déroulèrent entre la dernière décennie du gouvernement du général Porfirio Díaz (1876-1911) et les répercussions de la Révolution mexicaine de 1910. Le contexte social turbulent de ses années de formation contribua à développer son intérêt pour la politique et l’histoire mexicaines.
Lombardo Toledano eut le privilège de fréquenter de bonnes écoles. Après avoir terminé ses premières années d’études au Lycée Teziuteco, il fut envoyé, en 1909, à Mexico pour poursuivre sa scolarité à l’Ecole de Commerce Française. L’année suivante, il fut admis à la prestigieuse Escuela Nacional Preparatoria, où il termina ses études.
En 1914, il entra à la Faculté de droit de l’Université nationale du Mexique (UNM) – rebaptisée en 1929 Université nationale autonome du Mexique (UNAM) – et orienta bientôt ses études vers des thèmes sociaux. Avec six camarades, il fonda la Société de conférences et de concerts (1916), inspirée de l’expérience de l’Ateneo de la Juventud Mexicana [Université de la jeunesse mexicaine]– groupe qui rassemblait des intellectuels critiques de la pensée positiviste dominante sous Porfirio Díaz. Le but de cette société était de promouvoir une culture humaniste parmi les étudiants et les travailleurs à travers des lectures publiques sur le socialisme et des débats sur la justice, la démocratie, l’éducation et le syndicalisme. La période était favorable aux programmes progressistes. Les orientations sociales exprimées dans la nouvelle Constitution de 1917 issue de la révolution – la première à accorder un traitement universel aux droits des travailleurs, en plus de garantir les libertés politiques et individuelles d’expression, de culte et d’association – attestaient du contexte de profonde transformation du pays.
En 1917, Lombardo occupa le poste de secrétaire de l’Université populaire mexicaine, un poste qui lui permit de se rapprocher du mouvement syndical. Cette relation guida son travail d’homme politique et d’éducateur tout au long de sa vie. Deux ans plus tard, il obtint son diplôme de Droit. En 1921, il épousa Rosa María Otero Gama, avec qui il eut trois filles.
Au cours de cette décennie, il commença à répartir ses activités entre la politique, le syndicalisme et l’enseignement – activités dont il ne se départit plus. C’est également à cette époque qu’il approfondit son étude du marxisme, commençant à adopter le matérialisme historique comme clé de lecture et d’interprétation des sociétés humaines, et en particulier de la société mexicaine.
Dans le domaine syndical, en 1921, il rejoignit la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) – alors la plus grande organisation syndicale du pays –, devenant bientôt membre du Comité central (entre 1923 et 1932). Plus tard, cependant, il rompit ce lien en raison de divergences internes avec le courant collaborationniste pro-gouvernemental et ses activités syndicales s’étendirent à d’autres organisations.
La carrière proprement politique de Lombardo Toledano commença lorsqu’il occupa le poste de gouverneur par intérim de Puebla, dans un contexte de forte crise institutionnelle (entre 1923 et 1924). Il fut ensuite élu à deux reprises au poste de député du Congrès de l’Union (entre 1924-1925 et 1926-1928) pour le Partido Laborista Mexicano [Parti travailliste mexicain]. Ses mandats furent marqués par sa participation aux discussions pour la régulation des droits des travailleurs, qui aboutirent à la promulgation de la Loi fédérale sur le travail de 1931, qui approfondissait les aspects individuels, collectifs, administratifs et procéduraux du travail.
En 1927, il devint secrétaire général de la Confédération mexicaine des professeurs et en 1932, de la Fédération des Syndicats ouvriers du District fédéral (FSODF).
Entre 1933 et 1946, il dirigea la Revista Futuro, une publication qui réunissait l’intelligentsia révolutionnaire de l’époque, débattant de thèmes clés tels que la réalité mexicaine, le mouvement ouvrier international et la Seconde Guerre mondiale.
Dans le domaine éducatif, après avoir enseigné dans différents instituts au cours des années précédentes, Lombardo contribua à la fondation de deux universités : l’Université Gabino Barreda (qui n’exista que de 1934 à 1936) et l’Université ouvrière du Mexique fondée en 1936 (et toujours active aujourd’hui). Dans ce dernier établissement, il enseigna des matières telles que l’histoire des doctrines philosophiques, le matérialisme dialectique, l’économie politique, le droit du travail, l’histoire du Mexique et l’histoire de l’impérialisme, entre autres. Il occupa le poste de recteur dans les deux institutions (respectivement entre 1934 et 1936 et entre 1937 et 1968).
En 1935, il se rendit en Union soviétique, désireux de connaître de près l’évolution politique et sociale du pays. Il visita plusieurs villes (Kharkiv, Bakou, Tbilissi et Sotchi) et participa au VIIe Congrès de l’Internationale communiste (IC) à Moscou. Cet événement fut marqué par la directive donnée aux Partis communistes du monde de chercher à construire des « fronts larges », polyclassistes, pour contenir l’avancée des partis d’extrême droite dans leurs pays. Les délibérations de l’Internationale Communiste eurent une grande influence sur le développement des stratégies politiques défendues par les marxistes de la période.
Entre 1936 et 1940, Lombardo fut secrétaire général de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), créée en 1936 pour remplacer CROM. Durant cette période, il défendit le soutien de l’organisation au gouvernement du général Lázaro Cárdenas (1934-1940), qu’il considérait comme « progressiste », tant pour la mise en œuvre d’un programme de réforme agraire que pour avoir aidé à unir les Mexicains grâce à la propagande autour de la notion d’égalité et du renforcement d’une conscience « nationale » – deux héritages de la Révolution mexicaine.
Les bonnes relations qu’il entretint avec le gouvernement Cárdenas lui permirent de faire avancer de nouveaux projets dans les domaines syndical et éducatif. Ainsi, en 1938, il participa à la création de la Confédération des travailleurs d’Amérique latine (CTAL), la plus grande organisation syndicale du continent (qui à son apogée regroupait les syndicats de 14 pays américains), dont il sera président de sa fondation à sa fermeture, en 1963.
Entre 1945 et 1964, il exerça également la charge de vice-président de la Fédération syndicale mondiale (FSM), basée à Paris, de laquelle il reçut un soutien institutionnel pour mener des grèves et une aide financière pour soutenir les travailleurs au chômage et emprisonnés.
Dans l’immédiat après-Seconde Guerre mondiale, ses relations avec le nouveau gouvernement de Miguel Alemán Valdés (1946-1952), du Parti révolutionnaire institutionnel (Partido Revolucionario Institucional, PRI), se détériorèrent. Lombardo considérait que sa politique étrangère était trop alignée sur celle des États-Unis et que les politiques publiques adoptées par le gouvernement ne tenaient plus compte des demandes des classes populaires. Selon lui, il était donc impératif de rechercher de nouvelles façons de faire de la politique.
C’est de là qu’est née l’idée de fonder un parti dont l’objectif était de promouvoir les revendications de la population la plus pauvre, sans que cela ne signifie pour autant une opposition frontale au gouvernement – ce que Lombardo appelait « faire pression en soutenant, de manière indépendante et critique ». Le Parti populaire (PP) fut ainsi créé en 1948. Son programme gouvernemental comprenait trois principes fondamentaux : l’indépendance politique de la nation, l’amélioration des conditions de vie de la population et l’expansion du régime démocratique.
L’Union générale des travailleurs et des paysans du Mexique (UGOCM), créée en 1949, devait être l’organisation chargée d’assurer la principale base sociale de soutien prolétaire et paysan au parti. Lombardo se présenta à la présidence en 1952, arrivant en 4e position.
En 1960, le PP fut rebaptisé Parti populaire socialiste (PPS). Son programme appelait à l’instauration d’un régime démocratique « du peuple », sous la direction pratique et idéologique du prolétariat, mais allié aux paysans et aux secteurs de la bourgeoisie considérés comme progressistes, visant à préparer le terrain pour la construction d’une voie mexicaine vers le socialisme. Au nom de ce nouveau parti, Lombardo fut de nouveau élu au poste de député du Congrès de l’Union (1964-1967), trois décennies après son premier mandat.
Vicente Lombardo Toledano décéda en 1968, à l’âge de 74 ans. En 1994, sa dépouille fut transférée à la Rotonde des personnes illustres, cimetière qui rassemble les tombeaux de personnalités de l’histoire mexicaine.
2 – Contributions au marxisme
Dès sa jeunesse, Lombardo Toledano s’engage dans le débat politique et universitaire mexicain. Ses principales contributions sont consignées dans des livres, des articles de journaux, des brochures, des conférences et des entretiens. L’auteur y aborde une variété de sujets allant des débats théoriques sur la science aux réflexions sur la condition des indigènes et des femmes.
L’une de ses principales contributions concerne la manière dont il a cherché à interpréter l’histoire mexicaine. S’appuyant sur les catégories du matérialisme historique, il se consacre à la compréhension des particularités du développement social et économique de son pays et à l’analyse des différents impacts de la Révolution mexicaine (1910).
Pour ce faire, il part du constat que l’État mexicain n’a jamais été une entité politique pleinement indépendante, compte tenu de sa condition de nation historiquement soumise à l’influence des intérêts économiques et politiques des pays impérialistes. Ceux-ci, selon lui, opéraient dans le pays en association avec certaines fractions de la bourgeoisie agraire et urbaine, caractérisées par leurs liens avec les secteurs exportateurs et leurs intérêts arrimés à ceux du capital étranger.
Cette articulation entre les élites locales et l’impérialisme a accaparé le pouvoir de l’État, produisant un ordre social responsable à la fois de la perpétuation d’une structure productive primaire-exportatrice et du maintien d’une société très hiérarchisée, excluante et dépourvue d’une véritable composante nationale. Écrivant dans l’entre-deux-guerres, Lombardo défend l’idée que, pour qu’il y ait un véritable changement dans le mécanisme social hérité, il faut que l’État soit capable de défendre son autonomie politique face aux attaques de l’impérialisme états-unien, ce qui suppose le renversement de la classe dirigeante traditionnelle associée aux latifundia.
Sur ce point, Lombardo accorde une importance particulière à la Révolution mexicaine, considérée comme un événement majeur, à l’origine de nouvelles orientations – la lutte anti-impérialiste et la réforme agraire devenant des références centrales pour les gouvernements ultérieurs qui se réclament de l’héritage des idéaux révolutionnaires. Mais un tel changement de direction ne peut survenir sans lutte politique. Il est donc nécessaire d’organiser les travailleurs, en poussant à la formation d’un front ample soutenu par les fractions « progressistes » de la bourgeoisie nationale. La pression exercée par la société civile fournirait ainsi un soutien populaire à de nouveaux dirigeants déterminés à mettre en œuvre des programmes révolutionnaires.
Sa compréhension du fait que la Révolution a ouvert de nouvelles possibilités d’action politique le conduit à réfléchir à la formation et au développement du Mexique en tant qu’État et que nation. Pour lui, la révolution démocratique bourgeoise mexicaine n’a pu se réaliser qu’après un long processus historique pétri de contradictions et marqué par trois événements disruptifs: l’Indépendance de 1820, les réformes de Benito Juárez de 1857 et la Révolution de 1911.
Ainsi, l’indépendance a fait du Mexique une nation formellement autonome, mais ses idéaux d’émancipation associés à la formation d’une société de citoyens libres et d’un gouvernement organisé selon les principes républicains, ne se sont pas concrétisés. Après trois siècles de colonisation, le Mexique indépendant avait hérité d’un mode de production « semi-féodal » basé sur la concentration des terres entre les mains d’une minorité, sur l’abondance de main-d’oeuvre, en majorité des paysans sans qualifications professionnelles et vulnérables à l’exploitation par les propriétaires fonciers, et sur la forte influence politique de l’Église et d’un État garant des monopoles et des privilèges des classes dominantes.
Avec les réformes1 promues par Benito Juárez (1857-1861), les propositions sociales et politiques apparues dans le contexte de l’indépendance sont relancées : la constitution de 1857, d’inspiration libérale, cherche à reproduire un État de droit moderne. De nouvelles lois sont établies, garantissant la séparation entre l’État et l’Église, et des mesures supplémentaires sont prises pour supprimer le pouvoir ecclésiastique, comme la nationalisation des propriétés du clergé.
Cependant, les progrès réalisés par la Réforme perdent de leur vigueur avec les événements ultérieurs, marqués par la 2e intervention française au Mexique (1862-1867) et le long gouvernement autoritaire de Porfirio Díaz, qui se caractérise par la forte expansion des investissements étrangers dans le pays, renforçant les liens de dépendance à l’égard du capital anglais et états-unien. Par ailleurs, les rapports de travail dans les campagnes restent majoritairement structurés autour de « rapports d’exploitation semi-féodales », tandis que le secteur industriel est encore balbutiant et la concentration des revenus demeure très forte. Néanmoins, le chemin vers la révolution est progressivement pavé par l’augmentation des conflits entre les différents secteurs de cette société en mutation : les travailleurs ruraux, les industriels et les petits propriétaires fonciers ruraux s’opposent fréquemment aux aspirations des grands propriétaires terriens et les secteurs nationalistes manifestent leur opposition à la domination du capital étranger. Ce sont ces contradictions qui mènent à la révolution mexicaine de 1910.
Par « révolution », Lombardo Toledano entend un mouvement de masse, nécessairement composé par les secteurs défavorisés, comme les ouvriers urbains et les paysans. Le phénomène est le produit de contradictions existant au sein des sociétés, à un certain moment de l’évolution historique de l’État. Elle conduisent au remplacement de l’ordre social existant par un nouvel ordre, érigé sur un nouveau régime de propriété et l’arrivée au pouvoir d’une nouvelle classe dominante. Une révolution ne se termine donc pas avec la prise du pouvoir, mais à l’issue d’un processus long, au moment où un nouveau système social se trouve finalement consolidé.
En ce sens, la Révolution de 1910 joue un rôle particulier : elle représente le point culminant de la révolution nationale-bourgeoise, résultat d’un long processus commencé avec l’indépendance. C’est, pour Lombardo, le dernier épisode d’une lutte séculaire contre le pouvoir latifundiaire, considéré comme l’incarnation de la « féodalité » locale. Elle comporte également une composante originale : c’est la première révolution de l’histoire ouvertement anti-impérialiste, au-delà de ses colorations libérales et anti-féodales. Ainsi, l’auteur perçoit le contexte de l’entre-deux-guerres avec un optimisme relatif, dans la mesure où l’affaiblissement du pouvoir du latifundium crée les conditions matérielles pour le développement des forces productives mexicaines – ce qui se manifeste à la fois par les programmes d’industrialisation soutenus par les gouvernements révolutionnaires et par l’expansion et la consolidation d’une classe ouvrière urbaine et organisée.
Cette compréhension de l’histoire mexicaine et de la situation politique guide l’action militante de Lombardo. On retrouve, dans ses écrits et ses déclarations, une tentative de contribution à la formation d’une conscience de classe émancipatrice, capable d’élever le prolétariat à la condition de sujet historique transformant la réalité.
Dans les débats académiques, le marxiste mexicain oppose le matérialisme dialectique aux autres traditions philosophiques, et défend sa supériorité. Ses références à « l’idéalisme » sont révélateurs à cet égard, interprétant ce courant comme étant une doctrine visant à légitimer un ordre bourgeois en crise à l’heure de l’impérialisme de la fin du XIXe siècle, et donc incompatible avec la nouvelle orientation de l’histoire. Les contradictions entre idéalisme métaphysique et matérialisme dialectique sont également vérifiées, selon lui, à travers les prémisses adoptées par chaque courant. L’idéalisme métaphysique prend comme point de départ des éléments tels que la primauté de la pensée sur l’être, l’immuabilité de l’univers et la conception d’une réalité façonnée par une perspective subjective. De son côté, le matérialisme dialectique met l’accent sur la primauté de la matière sur l’esprit, un univers changeant et constamment en mouvement et l’existence d’une réalité concrète des choses, qui peut être appréhendée par la raison. En parvenant à une véritable conscience de la réalité, l’individu devient capable de se libérer de l’aliénation morale et matérielle et d’agir de manière créative et transformatrice.
On peut retrouver ces idées dans le débat qui oppose Lombardo et Antonio Caso, philosophe et professeur émérite de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), représentant du courant idéaliste. Au cours de leur célèbre controverse, ils discutent de sujets liés aux manières de concevoir la nature et la culture, aux priorités académiques et aux méthodes d’enseignement de l’histoire et de l’éthique. Mais le sujet qui eut le plus grand impact fut celui du positionnement idéologique des universités face aux problèmes du monde moderne. La polémique débuta lors du 1er Congrès des universités mexicaines (1933), s’étendant plus tard à une série d’articles se répondant les uns aux autres publiés dans le journal El Universal. Tandis que Caso défend la pluralité des points de vue au sein de l’université, Lombardo insiste sur l’adoption du matérialisme dialectique comme méthode de référence pour l’enseignement public – pour lui, ce n’était qu’ainsi que les jeunes apprendraient comment agir pour rendre la société plus juste.
Dans le cadre des luttes syndicales, Lombardo Toledano défend l’alliance des travailleurs urbains avec d’autres secteurs de la société comme les paysans, les artisans, les intellectuels, les petits commerçants, une partie de la bourgeoisie et les groupes associés au centre politique afin de rassembler les forces capable d’influencer le cours de la politique nationale, en particulier les gouvernements proposant un programme progressiste. La stratégie d’alliance découle d’un constat pragmatique : le prolétariat mexicain, bien que potentiellement révolutionnaire, n’est pas politiquement autosuffisant. L’objectif est donc de débloquer le développement des forces productives pour que l’État puisse accéder à l’indépendance économique et politique. Le travail de Lombardo avec les centrales syndicales dans les années 1920 et 1930, telles que la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), la Confédération générale des ouvriers et des paysans du Mexique et la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), reflète cette préoccupation.
Au niveau international, Lombardo Toledano défend l’articulation des luttes syndicales mexicaines avec celles qui ont lieu en Amérique latine. Selon lui, la création d’un réseau de solidarité internationale permet de renforcer chacun des syndicats dans ses revendications locales. Cette interprétation a des répercussions dans le domaine de l’action politique : Lombardo Toledano conçoit et contribue à créer, en 1938, une organisation chargée d’articuler des stratégies communes pour les centrales syndicales des pays d’Amérique latine : la Confédération des travailleurs d’Amérique latine (CTAL). Son objectif principal est de soutenir les gouvernements démocratiques et populaires, les syndicats représentant leur principale base sociale. En somme, la CTAL reflète une préoccupation à la fois pour la construction d’un réseau de soutien institutionnel aux luttes d’émancipation nationale du continent, et pour la contention des intérêts expansionnistes des États-Unis dans la région.
Lombardo Toledano reste indépendant de l’Internationale Communiste et du Parti communiste mexicain (PCM). Cependant, il soutient les actions de l’organisation et défend le régime soviétique, considérant que ces deux éléments représentent des fronts importants dans la lutte anti-impérialiste. Lorsque Léon Trotsky obtient l’autorisation de s’exiler au Mexique (1936-1940), Toledano profite de sa position de secrétaire général de la CTM pour manifester son mécontentement. Il considérait en effet la pensée trotskyste comme sectaire et contre-révolutionnaire, notamment en raison de la critique qu’elle faisait des stratégies de formation d’alliances larges dans lesquelles les agendas de la classe ouvrière convergeaient avec ceux d’autres secteurs de la société.
Dans la période d’après-guerre, la pensée de Lombardo Toledano est marquée par l’émergence de la Guerre froide et par la montée de l’anticommunisme aux États-Unis et dans d’autres pays américains. Dans ce nouveau contexte, les relations précédemment établies avec les organisations syndicales de différents pays du continent se détériorent. Pour Lombardo, l’ingérence croissante des gouvernements états-unien en Amérique, qui se manifestent par l’expansion du pouvoir de leurs multinationales et le soutien aux coups d’État contre les gouvernements progressistes (comme au Guatemala en 1954, en République dominicaine en 1963 ou au Brésil en 1964), exprime l’action des forces contre-révolutionnaires, chargées d’arrêter le processus de formation d’États politiquement indépendants, dotés d’industries nationales et d’organisations syndicales actives.
Les contradictions de cette situation historique ont également permis l’avènement d’événements victorieux dans le camp socialiste. La Révolution cubaine (1959), par exemple, est saluée par Lombardo et considérée comme un moyen de propager les idéaux émancipateurs de la Révolution mexicaine à travers le continent. Ce séisme renforce chez Toledano la perception selon laquelle la lutte anti-impérialiste et prolétarienne doit être menée à la fois sur le terrain national et à l’échelle internationale.
3 – Commentaire sur l’oeuvre
Profondément marqué par les conséquences de la Révolution mexicaine, Lombardo Toledano revendique l’héritage intellectuel marxiste et léniniste pour interpréter l’histoire de son pays, penser la conjoncture politique et proposer des stratégies d’action collective. Ses écrits comprennent des entretiens, des articles et des livres dans lesquels il débat de questions diverses (théoriques, politiques ou syndicales), défendant l’industrialisation, l’expansion des droits du travail, la formation de syndicats combatifs et un système éducatif « progressiste » qui considère l’éducation comme un ferment de transformation sociale.
Ses premiers livres datent de 1919 : El derecho público y las nuevas corrientes filosóficas (Mexico : Imprenta « Victoria »), fruit de son travail final à la Faculté de Droit (UNM); et La influencia de los héroes en el progreso social (Mexico: Imprenta « Victoria »), basé sur une conférence donnée pour l’Alliance des cheminots mexicains, dans lequel il discute de questions sociales dans une perspective de philosophie de la morale et de la justice.
C’est au cours des années 1920 qu’il se fait connaître dans le débat national, grâce à ses interprétations du processus historique de formation du Mexique et ses opinions sur la situation politique mexicaine et internationale. Les œuvres de cette période abordent des thèmes liés à l’enseignement qui devrait prévaloir dans les écoles et les centres de formation publics, comme c’est le cas dans Ética: sistema y método para la enseñanza de la moral en las escuelas elementares y profesionales (Mexico : Ediciones México Moderno, 1922). Surtout, on recense des textes qui étudient historiquement la relation entre l’impérialisme américain, les élites agraires mexicaines et la condition des travailleurs dans le pays, cherchant à réfléchir sur les éléments qui définissent le caractère de la lutte des classes à l’époque où il écrit, tels que : La doctrina Monroe y el movimiento obrero (Mexico : Talleres Linopográficos “La Lucha”, 1927), La libertad sindical en México (Mexico : Talleres Linop. “La Lucha”, 1927), Bibliografía del trabajo y la previsión social en México (Mexico : Secretaria de Relaciones Exteriores, 1928), et El contrato sindical de trabajo (Mexico : Talleres Linop. “La Lucha”, 1928).
Ces recherches centrées sur l’histoire économique et sociale du Mexique amènent l’auteur à systématiser sa propre interprétation du processus de formation de l’État et de la nation mexicaine, exposée dans la conférence « El sentido humanista de la Revolución Mexicana », publié plus tard sous forme d’article (Revista de la Universidad de México, tome I, n. 2, 1930), dans laquelle il cherche à interpréter la Révolution de 1910 suivant une perspective matérialiste historique. Son argument central soutient que la révolution démocratique bourgeoise mexicaine avait finalement été réalisée avec la Révolution de 1910, après une longue histoire marquée par des moments d’inflexion cruciaux, tels que l’Indépendance (1820) et les réformes de Benito Juarez (1857).
Dans les années suivantes, il se consacre à la fois à des thèmes plus spécifiques et anthropologiques et à des approches généralistes et théoriques. Dans Geografía de las lenguas de la Sierra de Puebla (Mexico : Sección Editorial, 1931), il propose une approche pédagogique scolaire adaptée à chaque région linguistique, valorisant le rôle des langues autochtones plutôt que la langue espagnole, qui serait plus efficace pour l’enseignement, car elles font partie de la la façon dont ces populations façonnent leur compréhension de la vie et du monde.
Un viaje al mundo del porvenir [Un voyage vers le monde du futur] (Mexico : Universidad Obrera de México, 1936) rassemble six conférences dans lesquelles Lombardo analyse le processus de transformation sociale et économique de l’Union soviétique, tirant les leçons de cette expérience pour réfléchir à l’orientation de la Révolution mexicaine et projeter des scénarios futurs.
Au cours des années suivantes sont publiés : Escritos filosóficos (Mexico : Éditorial México Nuevo, 1937) et El papel de la juventud en el progreso de México [Le rôle de la jeunesse dans le progrès du Mexique] (Mexico : El Popular, 1940). Parmi d’autres textes de cette période figurent : Nuestra lucha por la libertad (Mexico : Univ. Obrera de México, 1941), Actualidad militante de la obra y de los ideales del padre Hidalgo (Mexico : Univ. Michoacana, 1943) et Johann Wolfgang von Goethe (Mexico : Bewegung Freies Deutschland, 1944).
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Lombardo publie Diario de un viaje a la China Nueva [Journal d’un voyage en Chine nouvelle] (Mexico : Futuro México, 1950), dans lequel il présente un récit de voyage décrivant son voyage du Mexique à la Chine au cours de l’année révolutionnaire de 1949. Le voyage commence à Amsterdam, d’où il part en train pour Prague puis Moscou, pour ensuite, via le chemin de fer transsibérien, rejoindre Pékin, où il participe à une conférence de la FSM. Dans le livre, il consigne également ses impressions sur la Chine, notamment sa capitale, avant de commenter son retour au Mexique, via l’URSS.
Dans le livre Teoría y práctica del movimiento sindical en México (Mexico : Univ. Obrera de México, 1961), l’auteur retrace l’histoire du mouvement syndical mexicain, en comparant le processus historique de sa formation et de son développement avec les débats théoriques sur le mouvement syndical depuis la Ie Internationale. Les textes présents dans l’ouvrage correspondent à trois conférences (« La teoria sindical », « Origen y evolución del movimiento sindical mexicano » et « Los problemas de la unidad ») organisés par le Front National d’Unification révolutionnaire des Professeurs.
En 1962, sont publiés La filosofía y el proletariado (Mexico : Morelia) et La izquierda en la historia de México (Mexico : Edic. del Partido Popular Socialista). Ce dernier rassemble des textes écrits entre 1961 et 1962, dans lesquels Lombardo discute du concept politique de « gauche » dans l’histoire du Mexique. Selon lui, l’idée de « gauche » est liée à tout mouvement contre les gouvernements impérialistes et en faveur de la justice sociale et du progrès économique des travailleurs. Dans cette optique, la résistance indigène à l’invasion européenne serait le germe de la gauche au Mexique, qui se transformerait ensuite au fil des siècles. La Conquête, l’Indépendance et la Révolution constituent différents événements de l’histoire mexicaine, au cours desquels les pensées libertaires entrent en conflit avec les forces réactionnaires de ces périodes – principalement la Couronne espagnole, l’Église catholique, la bourgeoisie exportatrice liée aux intérêts impérialistes. Dans un essai de cet ouvrage, intitulé « Révolutions et partis politiques », l’auteur utilise la Révolution cubaine comme exemple paradigmatique des révolutions modernes en Amérique latine. En la comparant à la Révolution mexicaine, il souligne les différences entre les deux mouvements et les deux époques historiques. Dans le cas cubain, le soutien international, principalement lié à la formation du bloc socialiste après la Révolution russe (après la Révolution mexicaine) et le soutien de la classe ouvrière nationale, mobilisée au cours des décennies précédentes par le Parti socialiste populaire cubain, ont constitué des différences vitales entre les deux pays. De telles différences renforcent la conviction de Lombardo que la stratégie politique de la gauche mexicaine, dans les années 1960, doit toujours être celle de la recherche d’un front ample contre les intérêts impérialistes. Ce calcul repose sur deux prémisses : la gauche, seule, ne représentait pas la majorité de la pensée politique nationale et tous les groupes qui ne s’identifient pas à la gauche ne sont pas nécessairement de droite ou favorables à l’impérialisme.
Dans le livre Moscú o Pekin: la via mexicana al socialismo (Mexico: Partido Popular Socialista, 1963), l’auteur utilise les expériences socialistes chinoises et soviétiques comme miroir pour identifier les particularités historiques du Mexique et réfléchir au développement d’une voie mexicaine vers le socialisme dans le contexte de l’époque. Sont également publiés la même année : La batalla de las ideas de nuestro tiempo (Mexico : Univ. Obrera de México, 1963); La Constitución de los cristeros (Mexico : Edit. Librería Popular, 1963) et Idealismo versus materialismo: polémica Caso-Lombardo (Mexico : Univ. Obrera de México, 1963), une compilation d’articles liés à la « Controverse Caso – Lombardo Toledano ».
Le livre Summa (Mexico : Univ. Obrera de México, 1964) défend le rôle de la raison humaine dans la création d’un destin commun et la dimension centrale de la responsabilité individuelle. Pour Toledano, les pays capitalistes sont entrés dans la phase finale de leur développement, aggravant toujours plus leurs contradictions internes. Dans ce contexte de crises multiples, les conditions sont mûres pour la « lutte entre ce qui meurt et ce qui émerge ».
L’année suivante est publié son dernier ouvrage de son vivant : Partido de cuadros o partido de masas (Mexico : Secretaria de Educación Política y Propaganda del PPS, 1965).
Après la mort de Lombardo Toledano, des livres rassemblant des textes sur des sujets variés sont publiés, certains regroupant des écrits abordant un certain sujet à différentes époques, c’est notamment le cas de la question agraire, des syndicats, de la condition indigène et des débats philosophiques. En 1990, presque tous ses textes sont organisés pour la publication de ses Obras Completas (Puebla : Gobierno del Estado de Puebla), divisées en trois volumes.
Parmi ces livres posthumes, on peut mentionner El problema del índio (C. México : SepSetentas, 1973), avec des essais sur la question indigène, dans lesquels il avance que les indigènes n’ont pas été annihilés dans les Amériques, mais sont soumis à un régime de servitude, et que malgré l’assujettissement historique et l’effondrement civilisationnel des autochtones, leur résistance culturelle demeure forte. En torno al problema agrario (Mexico : Confederación Nacional Campesina et Partido Popular Socialista, 1974) rassemble des articles sur la question agraire, les spécificités de la production rurale et la réaction promue par les propriétaires fonciers. Une autre œuvre posthume remarquable est La batalla de las ideas en nuestro tiempo (Mexico : Univ. Obrera de México, 1975), dans laquelle il analyse l’évolution de la pensée humaine, depuis les conceptions magiques et religieuses jusqu’à la confrontation entre les thèses du matérialisme et de l’idéalisme.
Le livre Escritos a la juventud (Mexico : Centro de Est. Filosóficos, Políticos y Sociales V. Lombardo Toledano, 2013) rassemble des textes de la période 1938-1968 qui ont en commun le fait de considérer de la jeunesse comme agent historique transformateur de la réalité, selon des thèmes variés : analyse de la conjoncture, notamment avec « Las tareas de la juventud mexicana frente a los problemas del país » (1948), interprétations de l’histoire mexicaine, avec «Tesis sobre México : Programa del Partido Popular » (1957) et « Carta a la juventud sobre la Revolución Mexicana, su origen, desarrollo y perspectivas » (1960).
En tant que journaliste, Lombardo Toledano a publié des articles dans plusieurs journaux et revues, comme Excélsior, El Heraldo, El Universal, Hoy, Siempre, Democratie Nouvelle, entre autres. L’Université ouvrière du Mexique abrite la collection « Lombardo Toledano », composée de milliers de documents et de photographies qui témoignent de moments importants de l’histoire du mouvement ouvrier du Mexique et du monde au XXe siècle.
Le Centre d’études philosophiques, politiques et sociales Vicente Lombardo Toledano a étṕe créé en 1972, Il est installé dans l’ancienne résidence du marxiste, dans la capitale mexicaine, et est dédié à la systématisation et à l’organisation non seulement de son œuvre, mais aussi d’ouvrages de référence liés à l’histoire de l’Amérique latine et des travailleurs.
Les textes de Lombardo peuvent être consultés sur des portails tels que le Centro de Información y Documentación Alberto Beltrán (https://cid-albertobeltran.cultura.gob.mx) et Memória Política de México (www.memoriapoliticademexico.org)
4 – Bibliographie de référence
BOLÍVAR MEZA, Rosendo. Vicente Lombardo Toledano: vida, pensamiento y obra. Cidade do México: Instituto Politécnico Nacional, 2007.
DROMUNDO, Chauhtémoc Amezcua. “El marxismo lombardista. Vigencia y aportes a la transformación revolucionaria”. Em: MASSÓN, Caridad (org.) Las izquierdas latinoamericanas. México: Ariadna, 2017.
ILLADES, Carlos. El marxismo en México. Una historia intelectual. México: Taurus, 2018.
LOMBARDO, Raúl Gutiérrez. Vicente Lombardo Toledano: apuntes para una biografía. México: Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales V. Lombardo Toledano, 2003.
SPENSER, Daniela. En combate: la vida de Lombardo Toledano. C. México: Debate, 2018.
______. “Historia, política e ideología fundidas en la vida de Vicente Lombardo Toledano”. Desacatos, n. 50, C. México, 2016.
WILKIE, James W.; WILKIE, Edna M. de. Mexico visto en el siglo XX. C. México: Inst. Mexicano de Investigaciones Económicas, 1969.
Notes
* Pedro Rocha F. Curado est coordinateur du Núcleo Práxis-USP et éditeur du Dictionnaire Marxisme en Amérique. Il est professeur de l’Institut des Relations internationales et de la Défense de l’UFRJ, docteur en Économie politique (UFRJ), bachelier en Sciences sociales (UFRJ), avec un post-doctorat en relations internationales à l’EHESS (France) et à l’UFRJ. Il est également chercheur au Laboratório de Estudos em Segurança e Defesa. Il est l’auteur, entre autres œuvres, de : A guerra fria e a “cooperação ao desenvolvimento” com os países não-alinhados (UFRJ/EHESS, 2014).
* Athos Vieira est professeur d’histoire dans le secondaire (SME/SP) et chercheur au sein du Núcleo Práxis-USP. Il a obtenu une licence en Histoire à l’Université fédérale de Rio de Janeiro et un master en Sciences politiques et un doctorat en Sociologie de l’Institut des Etudes sociales et politiques de l’UERJ. Il est l’auteur, entre autres œuvres de A gota orvalina da Belle Époque: uma história social da cocaína no Rio de Janeiro durante a Primeira República (IESP-UERJ, 2020).
* Article édité par Joana A. Coutinho, Yuri Martins-Fontes et Paulo Alves Junior, et originellement publié sur le portail du Núcleo Práxis-USP, en tant que notice du Dictionnaire Marxisme en Amérique, œuvre collective coordonnée par cette organisation. Sa reproduction sans fins commerciales et sans altération est autorisée. La source doit impérativement être citée (nucleopraxisusp.org). Les suggestions et les critiques sont les bienvenues, elles peuvent nous être communiquées à cette adresse : nucleopraxis.usp.br@gmail.com.
1 La période de la Réforme au Mexique (1855-1863) correspond à une phase de grandes réformes libérales visant à séparer l’Église de l’État et à moderniser le pays. Elle est marquée par des lois anticléricales et la promulgation de la Constitution de 1857, qui provoque la Guerre de la Réforme entre les factions libérales et conservatrices.