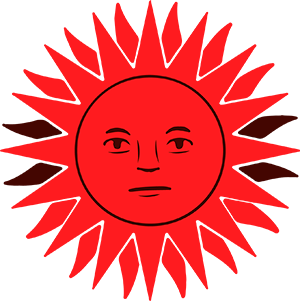Photographe, journaliste, traductrice et actrice, elle chercha à faire converger esthétique et éthique révolutionnaire. Elle fut militante communiste et féministe, active au sein du Secours Rouge International (de l’Internationale Communiste) au Mexique et dans d’autres pays
Par Ândrea Francine Batista et Yuri Martins-Fontes *
[Traduction du portugais : Aloys Abraham, Emma Tyrou, Félix Gay, Jean-Ganesh Faria Leblanc, Laure Guillot-Farnetti]
TINA MODOTTI; Modotti Mondini, Assunta Adelaide Luigia (Italienne – Mexicaine – Étasunienne, Údine/Italie, 1896 – Cidade do México, 1942)
1 – Vie et praxis politique
Assunta Adelaide Luigia Modotti Mondini, plus connue sous le nom de Tina Modotti, est née dans une famille de travailleurs italiens. Dès son plus jeune âge, la condition sociale de sa famille la contraignit à travailler avec sa mère, Assunta Mondini Modotti, comme couturière dans une usine. Son père, Giuseppe Saltarini Modotti, travaillait comme fabricant de vélos en bambou dans une petite ville d’Autriche, avant d’émigrer en 1906 aux États-Unis à la recherche de travail, tandis que la famille resta en Italie.
Enfant, Tina était déjà proche des luttes sociales : son parrain, Demétrio Canal, était membre du cercle socialiste d’Udine et son père, comme elle l’affirmait elle-même, était un « socialiste » et « un fervent partisan des causes syndicales », la conduisant ainsi à une mobilisation du 1ᵉʳ mai à une occasion.
Tina s’initia à la photographie auprès de son oncle Pietro Modotti, qui possédait un petit studio où elle se rendait fréquemment. À 16 ans, en 1913, elle partit à la rencontre de son père qui vivait à San Francisco (États-Unis). Elle y débarqua alors à un moment où l’hostilité à la migration italienne grandissait dans le pays. Elle entra dans le pays avec un statut d’étudiante et dut déclarer qu’elle n’avait aucun lien avec le mouvement anarchiste. Son père, Giuseppe, avait pris le nom de Joseph et travaillait dans un studio photographique qu’il cogérait, tandis que Tina et sa sœur Mercedez faisaient des services de couture.
Enchantée par l’art, Tina commença à fréquenter les théâtres et les expositions. C’est ainsi qu’en 1915, elle noua une relation avec le peintre et poète Roubaix de L’Abrie Richey – dit Robo –, qu’elle épousa. Ils déménagèrent à Los Angeles, où elle fut actrice dans des pièces de théâtre, des opéras et au cinéma; ses débuts dans l’industrie cinématographique eurent lieu dans le film muet The Tiger’s coat (1920).
Au fil des années et du fait d’une vie artistique chargée, sa relation avec Robo entra en crise. C’est alors qu’elle rencontra le photographe Edward Weston, avec qui elle apprit l’art de la photographie, commençant ainsi sa carrière dans ce domaine. Tina et Weston construisirent une relation étroite et durable, à la fois amoureuse et professionnelle.
En 1921, Robo s’installa au Mexique à l’invitation du ministère mexicain de l’Éducation. Il y emmena les œuvres de Tina afin de monter une exposition. En février 1922, cette dernière devait le retrouver, mais reçut la nouvelle de sa mort de la variole. Elle s’engagea alors à achever l’exposition qu’il avait commencée à l’Académie Nationale des Beaux-Arts, dans la ville de Mexico. En mars de la même année, la mort de son père la conduisit cependant à retourner aux États-Unis.
Peu de temps après, en 1923, Tina et Weston prirent la décision de quitter les États-Unis pour le Mexique, enthousiasmés par les possibilités d’y trouver un environnement plus favorable pour développer leur créativité artistique ainsi que leur relation affective. Installés dans la capitale, ils commencèrent à fréquenter les cercles d’artistes socialistes, rencontrant rapidement le peintre muraliste Diego Rivera (1886-1957). En 1924, Tina posa pour Weston, dans un essai photographique nu – dont les images seront plus tard utilisées par Rivera dans certaines allégories de ses peintures monumentales (notamment dans le bâtiment central du Secrétariat à l’enseignement public de Mexico).
À cette époque, Tina commença à travailler sur des projets photographiques avec le Mexicain Manuel Álvarez Bravo (1902-2002), en plus de contribuer aux campagnes de solidarité construites par l’Internationale communiste (IC). Elle y fut notamment active dans la campagne contre la condamnation de Nicola Sacco et Bartolomé Vanzetti (anarchistes italiens condamnés à mort et exécuté, aux États-Unis), et au sein du Comité de défense du Nicaragua (contre l’invasion étasunienne).
En 1927, Weston retourna définitivement aux États-Unis, Tina demeurant au Mexique. Cette même année, elle entra au Parti communiste mexicain (PCM), collaborant aux photos et aux traductions pour son journal El Machete. Pour elle, l’activité politique revêtait un caractère très sérieux, de même que la conscience de ses responsabilités dans l’organisation. Engagée dans la lutte révolutionnaire, sa photographie adopta une perspective de classe, documentant le quotidien de personnes ouvrières, les luttes paysannes et les mobilisations sociales. Elle devint la principale photographe du mouvement muraliste mexicain, documentant les œuvres de ses principaux représentants, qui étaient aussi des militants socialistes : Diego Rivera (qui, à son tour, la représentera dans ses peintures murales), José Clemente Orozco (1883-1949) et Xavier Guerrero (1896-1974). Des réunions informelles chez elle étaient l’occasion de discussions sur le rôle de l’art et de la littérature dans le processus révolutionnaire.
C’est dans ce contexte qu’elle rencontra, en 1928, son futur compagnon Júlio Mella (1903-1929), dirigeant du Parti communiste de Cuba, en exil au Mexique. La relation dura jusqu’à l’assassinat de Mella, l’année suivante, par des agents du dictateur cubain Gerardo Machado : au milieu des tensions politiques qui marquaient la période, ce dernier fut abattu une nuit de janvier 1929, alors qu’il marchait pour rencontrer Tina après une réunion de la section mexicaine du Secours rouge international (SRI, une organisation liée à l’IC qui venait en aide aux personnes persécutées et aux prisonniers politiques). Dans l’atmosphère anticommuniste de l’époque, compliquée par les différends entre les communistes eux-mêmes, le meurtre suscita beaucoup de spéculations, les journaux locaux accusant même Tina de la mort de Mella. Elle fut cependant rapidement blanchie après une enquête policière. Malgré l’épuisement émotionnel et politique dont elle souffrait, elle poursuivit fermement son militantisme dans le parti.
En 1929, Tina Modotti se concentra intensément à la photographie. Ainsi, elle organisa la « Première exposition révolutionnaire au Mexique » à la Bibliothèque nationale. Dans le même temps, les persécutions anticommunistes se multipliaient, imposant au PCM d’entrer dans la clandestinité : le siège du parti et le journal El Machete furent fermés, et plusieurs dirigeants expulsés du pays. Tina fut régulièrement l’objet d’une surveillance par la police, jusqu’à ce qu’en février 1930 elle soit finalement déportée. Le gouvernement de Mussolini tenta de l’extrader vers l’Italie. Cependant, grâce à l’action du SRI, elle put se rendre en Allemagne – juste au moment de la montée en puissance du parti nazi et d’une participation massive de la population aux meetings d’Adolf Hitler. En Europe, elle se consacra à des actions de défense des prisonniers politiques et effectua un travail clandestin pour l’IC, dans le cadre de la stratégie de lutte contre la progression nazie. Malgré son intention de retourner en Italie suite à ses retrouvailles avec l’Italien Vittorio Vidalli (un militant communiste rencontré au Mexique) elle s’installe à Moscou (1931). Elle y suspendit ses activités photographiques et se consacra avec zèle au travail de traduction au siège soviétique du Secours Rouge, pour lequel elle écrivit également des articles.
Tina Modotti devint alors une importante dirigeante révolutionnaire, communiste et internationaliste. Elle noua une relation avec l’Allemande Clara Zetkin (1857-1933), dirigeante socialiste et féministe, et rencontra la communiste mexicaine Concha Michel (1899-1990), qui se trouvait à Moscou, en 1932. En 1936, Tina (sous le pseudonyme Marie Pidal) et Vidalli (sous le pseudonyme Carlos Contreras) quittèrent Moscou pour combattre dans la guerre civile espagnole (1936-1939), en soutien de la lutte antifasciste. Dans le conflit, Tina s’engagea dans un bataillon féminin, travaillant notamment dans des missions secrètes et dans des hôpitaux, accompagnant des combattants révolutionnaires et des victimes de massacres. Elle travailla également avec le médecin communiste canadien Henry Norman Bethune (1890-1939) – l’un des premiers défenseurs de la médecine sociale (qui combattra à partir de 1938 dans l’armée populaire, en Chine, lors de la guerre sino-japonaise).
En 1937, Tina fut désignée par le SRI pour participer au IIe Congrès international des écrivains pour la défense de la culture, qui eut lieu à Madrid. L’événement se déroula en pleine guerre civile, grâce notamment au soutien de l’Alliance des intellectuels antifascistes. Parmi les participant·e·s qui débattirent, entre autres sujets, du rôle de l’écrivain·e dans la société, figuraient le Chilien Pablo Neruda (1904-1973), le Cubain Nicolás Guillén (1902-1989), l’Allemande Maria Osten (1908-1942) et l’Espagnole Margarita Nelken Mansberger (1894-1968).
Avec la défaite du camp républicain espagnol en 1939, Tina fut chargée d’organiser l’asile politique des réfugiés, permettant le passage de centaines de militants le long de la frontière entre la France et l’Espagne. Avec Vidalli, elle retourna ensuite au Mexique (sous le pseudonyme Carmen Ruiz Sánchez) et réussit grâce à ses contacts politiques à obtenir l’asile sur le sol mexicain pour plusieurs combattants impliqués dans le conflit. Elle collabora également à la traduction d’articles pour l’Association Antifasciste Garibaldi. Elle travailla alors beaucoup, bien qu’elle ne quittât que rarement la résidence où elle vivait avec Vidalli, sans chercher à renouer ses anciennes relations.
En janvier 1942, Tina et Vidalli se rendirent à un dîner chez l’architecte et militant communiste suisse Hannes Meyer. Tina y passa ses dernières heures, entourée de prose et de vin. Peu de temps après le départ de Vidalli, parti plus tôt du fait d’un rendez-vous au journal El Popular, Modotti prit un taxi pour se rendre chez elle et décéda en chemin. Les causes de la mort demeurent à ce jour incertaines (meurtre, suicide ou mauvaise santé). En réponse aux spéculations, le rapport médical concluait à une congestion viscérale généralisée et à une défaillance de multiples organes pouvant être causées par une crise cardiaque (récurrente dans la famille Modotti), ou un empoisonnement par une substance inconnue.
Tina fut enterrée au chant de l’Internationale. Ses obsèques, accompagnées de fleurs de lys et de personnes militantes et dirigeantes communistes, se déroulèrent sous l’égide du marteau et de la faucille. Vivant pleinement ses convictions, le travail de Tina Modotti – à la fois politique et photographique – fut un témoignage documentaire des conditions de la classe ouvrière mexicaine qui joua un rôle important dans la diffusion des idéaux socialistes en Amérique latine.
2 – Contributions au marxisme
Tina Modotti fut avant tout militante communiste et photographe, mais aussi journaliste, traductrice et actrice. À travers ses compositions photographiques, elle documenta la réalité quotidienne des ouvriers. Elle rejoignit le PCM, travaillant dans des journaux tels que El Machete, et participa au SRI en soutien aux prisonniers persécutés et politiques, agissant également dans les brigades d’agitation du Parti communiste allemand et lors de la guerre civile espagnole.
Intensément vivante, Tina Modotti n’hésita pas à relever les défis de son temps. À travers le photojournalisme, elle chercha à faire converger esthétique et révolution. Sa photographie se positionne comme un instrument éthique de la recherche sociale et des batailles politiques. Elle documente la culture, les maux et les luttes sociales, contribuant à la mémoire visuelle des personnalités publiques, figures militantes et dirigeantes, ainsi qu’aux actions politiques et culturelles de l’époque. A travers ses compositions photographiques, elle articula objectivité et subjectivité dans la quête de l’émancipation humaine. Elle produisit des photos qui portent une valeur documentaire de la réalité sociale vécue à partir de la lutte des classes de son temps, exprimant en images une relation intrinsèque entre l’art et la politique. Elle dépeignit l’identité et les luttes des travailleurs et travailleuses, des paysans et paysannes et des peuples autochtones au Mexique; documenta les peintures murales mexicaines, diffusa la perspective communiste de la transformation sociétale et plaida en faveur d’une sensibilité nécessaire pour comprendre la vie sociale. Elle accorda, en outre, une importance fondamentale aux femmes dans son travail.
Prenant dans la photographie une direction innovante, similaire à celle du mouvement muraliste mexicain en peinture, elle mit en évidence les interfaces entre l’esthétique de Marx et la lutte révolutionnaire. Diego Rivera, dans son article “Edward Weston et Tina Modotti” (1926), déclara que Tina, sa muse et compagne, produisait une photographie d’une “merveilleuse sensibilité”, à la fois sur le plan “abstrait” et “intellectuel”.
Tina n’appréciait pas que son travail photographique soit traité comme de l’art ; elle plaidait pour une production photographique sans recours aux manipulations ou effets artificiels. L’appareil photo était pour elle un outil, tout comme le pinceau pour le peintre. Elle considérait que la photographie, dans ses multiples fonctions, était un medium important pour documenter le présent. Sans trancher le débat sur le fait que la photographie soit ou non un art, elle soulignait avant tout l’importance de distinguer le bon travail photographique, dans lequel les limites de la technique sont acceptées pour exploiter les possibilités offertes par le médium, du mauvais, celui usant d’artifices pour plaire à certains goûts. Il s’agit là d’un débat inhérent à la relation entre l’art et la politique dans l’esthétique marxiste, bien que l’autrice n’utilise pas cette terminologie. La photographie, en tant que produit social, peut faire partie intégrante des processus d’aliénation et de fétichisme, mais en mettant en évidence les contradictions de la vie matérielle d’un moment historique donné, elle peut aussi contribuer aux connexions et aux synthèses du processus de prise de conscience émancipatrice.
Tina chercha à relier, à travers la photographie, des éléments de la vie quotidienne à la lutte politique, donnant à la notion d’« art » un sens spécifique. Mais, à un certain moment, son appareil photo devint insuffisant pour faire face à la dureté de la montée nazie-fasciste. Dans un changement de cap, elle se concentra sur le renforcement du Secours Rouge, en devenant sa dirigeante. Créé dans les années 1920, le SRI fonctionnait sous deux formats : en tant qu’organisation de masse, et par la composition de comités d’assistance juridique et matérielle pour les personnes prisonnières et exilées politiques. Ces actions furent essentielles pour sauver et protéger la vie d’innombrables militants et militantes qui subissaient des persécutions politiques, comme les Brésiliens Laura Brandão (1891-1942) et Octávio Brandão (1896-1980), exilés en URSS dans les années 1930 (des documents signés par Tina appuyèrent leur demande auprès de la section soviétique du SRI pour être reconnus comme exilés). Parmi les dirigeants de cette organisation figuraient également Clara Zetkin et la Russe Elena Stásova (1873-1966). En plus de traduire des articles pour des périodiques liés au SRI, Tina écrivit aussi sur des sujets tels que la réforme agraire mexicaine et la situation des veuves et des enfants face au fascisme. Ses quelques articles dessinent les contours d’une position anti-impérialiste et d’une perspective sociétale communiste. Elle accomplit également des tâches clandestines, essentielles pour la consolidation du mouvement communiste international.
Modotti rencontra le cinéaste soviétique Sergueï Eisenstein (1898-1948), qui, à son tour, dans son film Que viva México ! (1932) affirme avoir été influencé par les photos de Tina et Weston. Elle vécu aux côtés de Pablo Neruda, Frida Kahlo, Diego Rivera, Augusto César Sandino, Alexandra Kollontaï (ambassadrice au Mexique de 1925 à 1927) et avec la révolutionnaire espagnole Isidora Dolores Ibárruri Gómez (célèbre dirigeante communiste dite La Pasionaria).
Tina Modotti fut une femme communiste, internationaliste et féministe qui transgressa les coutumes de son temps. Dans ses relations, elle rechercha l’autonomie nécessaire pour maintenir son engagement et ses convictions révolutionnaires. Son action se situa à l’intersection de l’esthétique et la politique, entre liberté et engagement, et elle se définissait elle-même comme quelqu’un qui aspirait à jouir de toutes les possibilités que l’existence humaine donne à la vie.
3 – Commentaire sur l’oeuvre
L’œuvre écrite de Tina Modotti se compose de textes épars, d’articles publiés dans des revues et des journaux, ainsi que de correspondances – textes parmi lesquels nous commentons quelques-uns des plus importants.
En mars 1930, elle écrit un article pour le magazine péruvien Amauta (n. 29) intitulé « La contre-révolution mexicaine », où elle dénonce la persécution (arrestations et assassinats) des communistes, et accuse les autorités du pays d’avoir perdu toute « pudeur » dans leur « soumission aux capitalistes de Wall Street », en inventant, en plus de créer un « état psychologique hystérico-sentimental » dans l’opinion publique, des fictions dans lesquelles « complots » et « plans terroristes » se succèdent, mais qui ne sont rien d’autre que des farces destinées à « plaire aux lecteurs de la presse bourgeoise » qui acceptent « toutes sortes d’absurdités », confondant « communistes avec terroristes », et « anti-impérialistes avec fabricants de bombes destinées à tuer des présidents à travers l’Amérique latine ». Peu de temps après cette publication, Tina est exilée du pays.
Son rôle direct dans l’organisation SRI a été révélé dans deux lettres à Manuel Álvarez Bravo (25 mars et 9 juillet 1931), qui peuvent être lues sur le portail du Centre international des arts des Amériques au Musée des beaux-arts de Houston (ICAA, disponible en ligne : https://icaa.mfah.org). Dans cette deuxième lettre, elle commente le « suicide » d’une connaissance commune, qu’elle considère comme le « prototype de la classe parasitaire (et donc décadente) » : une femme sans « soucis matériels » qui, en raison de « soucis spirituels », est devenue « si compliquée au point d’être pathologique » ; une grande « tragédie », mais pas moindre par rapport à ceux qui « se suicident à cause de la faim », comme cela est alors documenté aux USA – où les « journaux bourgeois » eux-mêmes affirment que le suicide « par la faim » était devenu un « phénomène » collectif. De plus, elle indique ne pas réussir à consacrer de temps à la photographie face au rythme « bolchevique » du travail militant, et se trouver dans l’impossibilité de mener de front deux activités si essentielles. En effet, durant cette période, elle utilise rarement l’appareil photo, et toujours à des fins bien précises.
En tant que rapportrice des sections régionales du Secrétariat des Caraïbes (New York) et du Secrétariat sud-américain (Buenos Aires) de l’Internationale communiste, elle se consacre surtout à la lecture de la correspondance et des rapports, ainsi que des journaux et documents politico-syndicaux qui lui permettent de comprendre la situation politico-économique des pays de la région, pour ensuite établir des ponts avec le SRI, en traduisant le contenu dans un langage accessible et populaire à destination des publications de l’organisation. À titre d’exemple, on peut citer l’article « Les enfants et le Secours Rouge », publié dans le magazine allemand du SRI, en mars 1931.
Toujours à cette époque, alors secrétaire du Comité antifasciste de la Caraïbe, elle rédige le pamphlet « Le Secours rouge international dans les pays d’Amérique du Sud et des Caraïbes » (1933).
Dans le journal Ayuda, une publication éditée par la section espagnole du SRI pendant la guerre civile espagnole, Tina écrit des articles sous le pseudonyme Carmen Ruiz. Dans le texte « En défense de nos enfants » (Madrid, 3 mars 1937), elle déclare que l’un des principaux problèmes qui se posent face à l’avancée fasciste est la question de « l’enfance » – un thème que le SRI identifie, en raison de son esprit humanitaire, comme l’une de ses tâches principales. Au regard de l’importance des pertes, il n’est alors plus question de récupérer les enfants des personnes combattantes ou évacuées, d’organiser des garderies ou de livrer des vêtements et de la nourriture, car il n’y a plus d’endroit sûr dans la capitale. C’est pourquoi Modotti souligne la nécessité de les envoyer à l’étranger, où les organisations antifascistes du monde entier leur ont offert l’hospitalité – grâce à des comités spéciaux recueillant les enfants de combattants ou de ceux et celles tombés pour la défense de la cause – jusqu’à ce que les conflits prennent fin. Pour cela, elle plaide pour un large travail de publicité et de conviction des parents afin qu’ils puissent comprendre la proposition.
La correspondance de Tina avec Weston est abondante et a été recueillie dans des publications telles que : Vita, arte e rivoluzione : lettere a Edward Weston (1922-1931) [org. Valentina Agostinis] (Milan : Feltrinelli, 1994) ; et Una mujer sin país: las cartas de Tina Modotti a Edward Weston y otros papeles personales [org. Antonio Saborit] (Mexico : Cal y Arena, 2001). Dans l’une lettre des lettres contenues dans ces recueils (du 25 février 1930), Tina rapporte à son partenaire avoir été accusée de participer à l’attentat contre le président élu mexicain Pascual Ortiz Rubio, ce qui a abouti à son expulsion du territoire, après avoir a passé 13 jours en prison sous prétexte qu’elle était une « terroriste ».
La correspondance de Tina exprime fréquemment ses sentiments, ses pensées par rapport à l’art, la vie, les relations et la lutte politique. Dans une de ses lettres à Weston, datée de 1926, elle déclare avoir toujours cherché à respecter « les nombreuses possibilités de l’être qui est en chacun de nous », face au « conflit tragique entre la vie, qui change continuellement, et la forme, qui la fixe immuablement ». Dans une autre, de la même année, écrite à l’occasion du quatrième anniversaire de la mort de Robo, elle déclare qu’en triant ses anciennes affaires, elle a décidé de ne garder que celles qui concernaient la photographie, et le reste des choses “concrètes” qu’il aimait tant seraient soumises à une métamorphose qui les transformerait en choses “abstraites”, afin qu’elle puisse toujours les porter dans son cœur.
Quant à la photographie, c’est l’activité à laquelle Tina Modotti consacre le plus de temps dans sa pratique de la politique. Ses premiers travaux photographiques, toujours sous l’influence des dessins de Weston, sont publiés dans la revue El Maestro rural (Mexique). Son travail visuel se retrouve principalement dans le journal El Machete, organe officiel du Comité central du PCM, et dans revue Mexican Folkways, où elle travaille comme éditrice et photographe.
Dans ce dernier, elle publie le manifeste « A propos de la photographie » (Mexican Folkways, Nº. 4, 1929) – texte disponible sur le portail de l’ICAA. Dans l’essai, elle met en évidence le rôle de la photographie en tant qu’enregistrement documentaire d’une époque, affirmant que la photographie, telle qu’elle est réalisée dans le moment présent, sur la base de ce qui existe objectivement devant la caméra, serait un moyen perspicace d’enregistrer les manifestations de la vie réelle. Pour elle, la sensibilité et la connaissance des différentes dimensions de la réalité, ainsi que la compréhension de la place que nous occupons dans le processus historique, donnent à la photographie une place précieuse dans la production sociale – à laquelle chacun devrait contribuer. Le manifeste commence par noter que l’utilisation des mots « art », ou « artistique », en relation avec son travail photographique, a suscité une « impression désagréable » en elle, en raison du « mauvais usage et de l’abus qui en est fait ». Si ses photos étaient considérées comme différentes de celles produites par d’autres photographes, observe-t-elle, c’est parce qu’elle cherchait à « produire non pas de l’art, mais des photographies honnêtes, sans artifices ni manipulations, alors que la plupart des photographes recherchent encore des “effets artistiques” ou l’imitation d’autres moyens d’expression graphique ». Abordant la réflexion de Diego Rivera sur le sujet, elle considère qu’en son temps beaucoup n’étaient pas encore parvenus à accepter les « manifestations de notre civilisation mécanique », précisant que, pour elle, le mérite de la photographie est d’être la « voie la plus éloquente et la plus directe d’enregistrer le temps présent ». De plus, pour Tina, « peu importe que la photographie soit de l’art ou non », il s’agit plutôt de « faire la distinction entre la bonne et la mauvaise photographie » : par « bonne » il faut entendre celle qui « accepte toutes les limitations inhérentes à la technique photographique et profite de toutes les possibilités et caractéristiques qu’offre le médium » ; par « mauvaise photographie », il faut entendre celle qui est prise d’une sorte de complexe d’infériorité », qui ne permet pas d’apprécier « ce que la photographie a de propre, qui est spécifiquement sien » et qui conduit à recourir à des « imitations », des « contrefaçons ». La photographie, dit-elle, « précisément parce qu’elle ne peut être produite qu’au présent, et à partir de ce qui existe objectivement devant la caméra », s’impose comme « le moyen le plus satisfaisant d’enregistrer la vie objective dans toutes ses manifestations ». Elle a donc une grande « valeur documentaire », à laquelle s’ajoutent « la sensibilité » et la « compréhension » du sujet abordé – en plus, et surtout, de la clarté quant à la « place » que doit occuper une telle image dans le « développement historique » – il peut en résulter « quelque chose digne d’occuper une place dans la production sociale, à laquelle nous devons tous contribuer ».
Comme on peut le voir dans ces réflexions, la conception esthétique marxiste de Tina Modotti est attentive à la fois à l’aspect objectif de l’acte de photographier (en tant qu’enregistrement de la réalité), et à son aspect sensible (la sensibilité nécessaire pour situer le témoignage imagé dans le contexte de l’histoire, dans le tout qui constitue la réalité).
Entre 1927 et 1928, Tina Modotti est invitée à participer au projet de création Écoles libres d’agriculture. Le communiste indien Pandurang Khankhoje (1884-1967) est à l’origine de l’expérience, qui débute par des classes « itinérantes ». Tina prend une série de photos de recherches sur la production de maïs menées par Khankhoje lors de la construction de ces écoles. Ces images montrent des activités paysannes dans la municipalité de Texcoco (1927-1928), et une assemblée paysanne à Chipiltepec, où est fondée la première École d’agriculture Emiliano Zapata. Certaines de ces photographies sont conservées à la Fototeca Nacional de México. Il s’agit d’une production politiquement active qui a été témoin de l’organisation des paysans, dans le but de promouvoir la lutte sociale révolutionnaire. Sa photo « Hoz, canana y mazorca » [Faucille, cartouchière et épi de maïs], de 1928, a inspiré la construction de l’emblème de ces Écoles.
D’autres images, du milieu des années 1920, représentent le peuple dans le contexte du processus d’industrialisation, telles que : « Hilos telegráficos » [Fils télégraphiques] (1925) ; « Hombre cargando una viga » [Homme portant une poutre] (1927) ; et « Manos de mujer lavando ropa » [Mains de femmes lavant des vêtements] (1926). Elle a également photographié la lutte politico-économique communiste, comme dans : « Marcha de los trabajadores » [Marche des travailleurs] (1926) – dans laquelle elle dépeint des paysans marchant pour la réforme agraire ; « Sombrero, hoz y martillo » [Sombrero, faucille et marteau] (1927) ; « Campesinos leyendo El Machete » [Paysans lisant El Machete} (1928) ; « Mujer con bandera » [Femme avec un drapeau] (1928); le photomontage « La elegancia y la pobreza » [L’élégance et la pauvreté] (1928) ; et « Cantando corridos en Chiconcuac » [Chantant des corridos à Chiconcuac] (1928), qui montre Concha Michel jouant de la guitare pour des paysans.
Tina a également dépeint plusieurs personnalités de la lutte politique de son temps, comme Julio Mella, son compagnon, qui sera rapidement assassiné ; ébranlée, elle décide alors de faire le tour de l’État d’Oaxaca, enregistrant sa culture. A son retour, elle photographie des mobilisations, comme on le voit dans « Diego Rivera y Frida Kahlo en la manifestación del Primer de Mayo de 1929 ». En Allemagne, cependant, peu de ses photographies sont connues ; mentionnons : « Una vez más » [Encore une fois] (1930), qui montre le ventre d’une mère enceinte tenant un enfant dans ses bras.
En tant qu’actrice, Tina Modotti a participé à des films étasuniens, tels que : The Tiger’s Coat [Le manteau du tigre], 1920 (réalisé par Roy Clements) ; et Riding with Death [À cheval avec la mort], 1921 (réalisé par Jacques Jaccard).
Tina a également été représentée dans plusieurs peintures murales de Diego Rivera, ayant posé pour les œuvres « Tierra virgen » (1926), « La tierra abondante » (1926) et « Germinación » (1926-1927), entre autres. Dans l’exceptionnelle peinture murale « En el arsenal » (1928), du Secrétariat de l’instruction publique (Mexico), elle apparaît peinte, aux côtés de Frida Kahlo, distribuant des munitions au peuple et regardant fixement Júlio Mella, avec Vittorio Vidalli (1900- 1983) à côté.
4 – Références
BARCKHAUSEN, Christiane. Sur les traces de Tina Modotti. São Paulo : Alfa Oméga, 1989.
CASANOVA, Rose. « Huellas d’une utopie : les photographies politiques de Tina Modotti ». Alchimie (National Photo Library System) : Tina Modotti, fichier inédit, année 17, n. 50, Mexico, Impresora y Encuadernadora Progreso, janvier-avril. 2014.
MULVEY ; WOLLEN et al. Frida Kahlo et Tina Modotti. Documentaire (29 min.). Production : Arts Council of Great Britain/Modelmark (Royaume-Uni), 1983.
CROCHETS, Marguerite. Tina Modotti, photographe et révolutionnaire [Trans. V. Whately ; H. Lanari]. Rio de Janeiro : José Olympio, 1997.
JEIFETS ; Lazar; JEIFETS, Victor. L’Amérique latine dans l’Internationale communiste (1919-1943) : Dictionnaire biographique. Buenos Aires : CLACSO, 2017.
MARTINEZ DÍAZ (à droite) et al. Tina Modotti : le dogme et la passion. Documentaire (53 mn). Coproduction : FONCA/CINEMAZERO (Mexique/Italie), 2012. Disp. : https://vimeo.com.
MASSE, Patricia. “Tina Modotti et l’agrarisme radical au Mexique”. Alquimia (Sistema Nacional de Fototecas): Tina Modotti, Non. 50, cid. Mexique, Impresora Progreso, janvier-avril. 2014.
MELA, JA. “Lettre à Tina Modotti” (1927). Dans : GUANCHE. Mella : textes sélectionnés. La Havane : éd. La Memoria/Centre Culturel Pablo de la Torriente Brau, 2017.
MUZARDO, Fabiane. « Tina Modotti et les périodiques mexicains des années 1920 ». Art & Sensorium : Rév. Arts visuels interdisciplinaires internationaux, Curitiba, c. 6, non. 2, 2019.
PONIATOWSKA, Hélène. très bien. Mexico : ère des Ediciones, 1992.
Notes
*Andréa Francine Batista est professeur à l’Université fédérale du Paraná. Auteur, entre autres livres, de Mouvement paysan et conscience de classe : la praxis organisationnelle de Via Campesina Internacional en Amérique Latine (UFRJ).
*Yuri Martins-Fontes est écrivain, enseignant et journaliste ; Docteur en histoire économique (USP/CNRS). Auteur, entre autres livres, de Marx en Amérique (Alameda).
* Article édité par Yuri Martins-Fontes et Solange Struwka, et originellement publié sur le portail du Núcleo Práxis-USP, en tant que notice du Dictionnaire Marxisme en Amérique, œuvre collective coordonnée par cette organisation. Sa reproduction sans fins commerciales et sans altération est autorisée. La source doit impérativement être citée (nucleopraxisusp.org). Les suggestions et les critiques sont les bienvenues, elles peuvent nous être communiquées à cette adresse : nucleopraxis.usp.br@gmail.com.