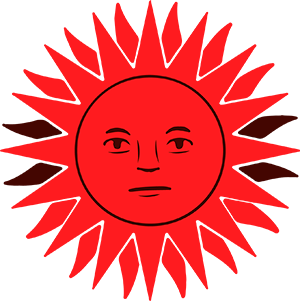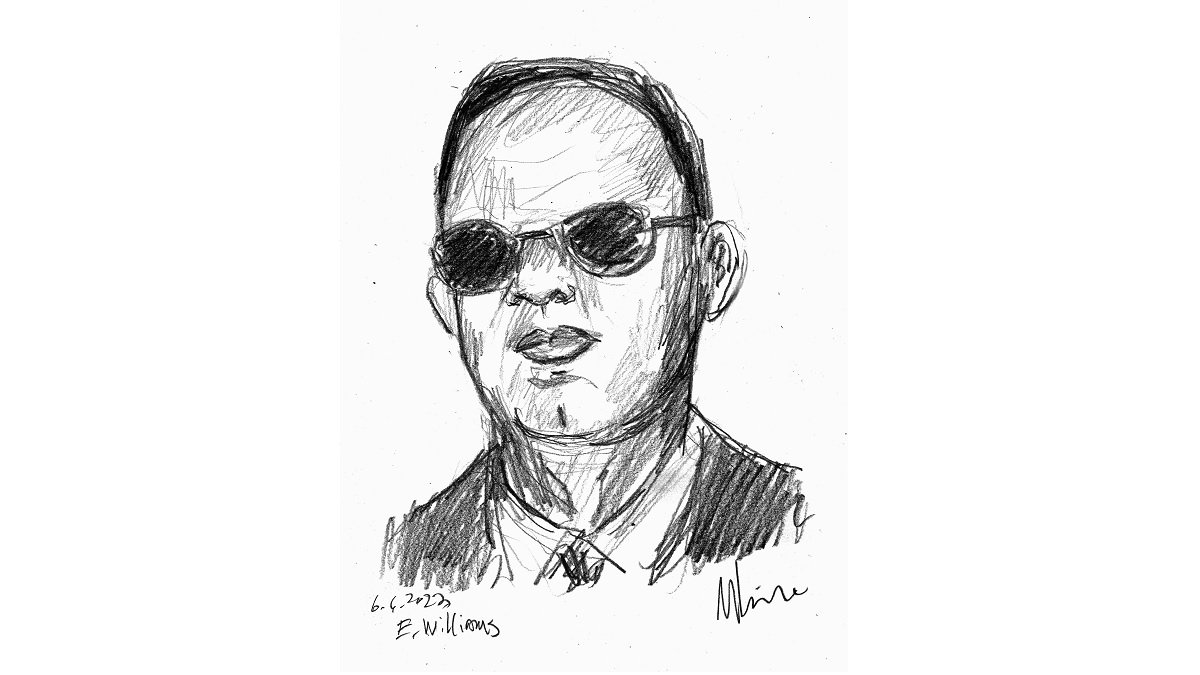Historien et professeur, il est à la tête du mouvement pour l’indépendance de Trinité-et-Tobago, dont il est Premier ministre pendant deux décennies. Il se distingue également comme l’un des marxistes à avoir mis en lumière les liens entre l’esclavage en Amérique et le capitalisme
Par Gustavo Velloso*
[Traduction du portugais : Aloys Abraham, Emma Tyrou, Félix Gay, Jean-Ganesh Faria Leblanc, Laure Guillot-Farnetti]
WILLIAMS, Eric (trinidadien; Port-d’Espagne, 1911 – Port-d’Espagne, 1981)
Vie et pratique politique
Eric Williams (1911-1981) est né dans la capitale de Trinité-et-Tobago, au début du XXe siècle, alors que le pays était encore une colonie spécialisée dans la production de cacao, de sucre, de noix de coco et d’huile pour approvisionner l’empire britannique. À cette époque, le passé esclavagiste était encore bien vivant, et avait laissé en héritage à cette société coloniale différentes formes d’exploitation du travail et une masse de travailleur·es, majoritairement noir·es, pauvres, analphabètes et sous-payé·es. L’administration coloniale fonctionnait selon le système de la « colonie de la couronne » (« crown colony system »), qui empêchait les autochtones d’élire leurs propres représentant·es au Parlement britannique. Une grande partie du pouvoir politique était concentrée entre les mains d’un seul homme – George Ruthven le Hunte (1908-1975) -, représentant du monarque anglais et dirigeant local.
Issu d’un milieu familial modeste, Eric Williams était le fils d’un petit fonctionnaire de la poste de la ville. Du côté maternel, le futur historien hérita d’une ascendance métisse aux racines africaines et françaises. Son enfance fut marquée par de nombreuses difficultés matérielles pour la famille, ponctuées toutefois de périodes plus clémentes. Élève brillant à l’école primaire, il obtint en 1922 une bourse pour entrer au prestigieux Queen’s Royal College [Collège royal de la Reine] de la capitale trinidadienne.
Il demeura à Port-d’Espagne jusqu’en 1932, année où il décrocha l’une des rares places réservées aux étudiants caribéens souhaitant être transférés à Oxford ou à Cambridge, en Angleterre. Au cours de ces années d’études précédant le voyage, il rencontra l’historien, journaliste et militant socialiste Cyril Lionel Robert James, également trinidiadien, dont les idées politiques le marquèrent et avec qui il traversa l’océan Atlantique. À Londres, il s’engagea dans des études d’histoires à Oxford. Il y établit des contacts avec un cercle radical d’intellectuels noirs anticoloniaux, qui comprenait, entre autres, les révolutionnaires Kwame Nkrumah et George Padmore, ainsi que James lui-même.
Après avoir excellé dans les cours d’histoire moderne, Eric Williams s’orienta vers la recherche historique, obtenant un doctorat en 1938. Un an plus tard, il commença à enseigner à l’université Howard de Washington (États-Unis), où il vécut jusqu’en 1948. Durant cette période, il participa activement aux débats sur les horizons qui s’ouvraient pour les pays caribéens – dont l’indépendance approchait. Entre 1943 et 1955, il fut membre de la Commission anglo-américaine pour les Caraïbes [Anglo-American Caribbean Commission], destinée à promouvoir le développement économique et politique des îles de l’archipel. Entretemps, Eric Williams était retourné à Trinité-et-Tobago (1948) et avait pris la tête d’un mouvement non-violent pour l’indépendance politique du pays.
En 1956, après des négociations avec la Grande-Bretagne, Trinité-et-Tobago obtint le droit de s’autogouverner concernant les affaires intérieures. La même année, Williams contribua à la fondation du Mouvement national populaire [People’s National Movement], un parti politique dont l’objectif était de mener à bien le projet d’indépendance. Nommé au poste de Premier ministre de la Fédération des Indes occidentales (1959-1962) – qui, outre Trinité-et-Tobago, comprenait alors les colonies de la Jamaïque, de la Barbade et des Îles sous le Vent –, Williams mena les négociations avec les Britanniques qui aboutirent à la proclamation de l’indépendance de son pays en 1962.
Figure centrale de la scène politique de Trinité-et-Tobago, il occupa le poste de Premier ministre de l’État indépendant entre 1962 et 1981, année de sa mort. Ses efforts à la tête de l’État de Trinité-et-Tobago furent particulièrement importants dans le domaine de l’éducation et de la modernisation de la structure productive nationale, à travers la diversification agricole et industrielle. Cependant, il conduisit cette transformation en ouvrant le pays aux capitaux étrangers. Cela valut à Williams une réputation de dirigeant modéré et certaines critiques de la gauche (ainsi que la prise de distance définitive de C.L.R. James).
L’un des épisodes les plus représentatifs de la gravité des tensions entre Eric Williams et l’aile radicale des milieux socialistes de Trinité-et-Tobago se produisit à partir de 1970 : mené par le mouvement Black Power, une vague de protestations contre le taux de chômage élevé et la présence d’entreprises étrangères dans le pays entraîna une escalade drastique de la violence. Bien que le dirigeant du pays se soit initialement déclaré favorable aux revendications des militant·es, son soutien ne suffit pas à contenir les protestations. Après la proclamation d’une grève générale et l’adhésion d’une partie de l’armée au mouvement, qui commença à réclamer la démission du Premier ministre, Williams déclara l’état d’urgence (qu’il suspendit lui-même en 1972), et fit réprimer les manifestant·es, allant jusqu’à demander l’intervention des États-Unis pour calmer la situation (demande qui ne fut pas suivie d’effet).
En raison de son rôle de premier plan dans le processus d’émancipation politique de son pays natal, de sa production en tant qu’intellectuel et de son action en tant qu’homme d’État, Eric Williams est considéré comme l’une des figures les plus influentes de l’histoire de Trinité-et-Tobago, et comme un « père de la nation ». Il a reçu de nombreuses distinctions nationales et internationales, tant pour ses efforts de rapprochements bilatéraux avec divers pays périphériques du système capitaliste que pour le pragmatisme de son gouvernement – qui s’est traduit par la coopération avec les pays du bloc capitaliste pendant la guerre froide.
Il est décédé chez lui dans son sommeil, à l’âge de 69 ans, en mars 1981.
Contributions au marxisme
L’engagement marxiste d’Eric Williams ne peut être qualifié de “théorique”. Il ne s’est jamais soucié de se rattacher à tel ou tel courant marxiste, de soumettre ses idées à l’épreuve d’un concept ou d’une catégorie spécifique du matérialisme historique, ni même de fonder sa production écrite sur ce qui peut ou non se trouver dans les textes classiques du marxisme. Il ressemble en cela à C.L.R. James, son ancien mentor, qui ne superposait pas aux processus historiques réels – qu’il observait – des formulations théoriques produites dans des contextes différents (ni celles de Trotski, qui l’a influencé, ni celles d’aucun autre penseur).
La pensée d’Eric Williams s’est formée avant tout, pour paraphraser Lénine, au travers de son talent pour développer des analyses concrètes de réalités historiques tout aussi concrètes. L’objet premier des préoccupations de l’auteur, visible du début à la fin de sa carrière, est le monde réel, dans sa complexité nécessaire et immanente (c’est-à-dire les dynamiques historiques réelles en elles-mêmes). Dans sa production historiographique, des thèmes tels que les processus de transformation sociale, les contradictions opérant dans le monde des hommes et des femmes réel·les, les inégalités économiques et les relations conflictuelles entre les classes sociales sont des sujets constants.
Opposé à la simple application de modèles externes pour interpréter la réalité particulière des Caraïbes, Eric Williams privilégie l’étude de l’histoire de la région selon ses propres logiques de fonctionnement. Cette méthode lui permet de porter un regard attentif sur les spécificités historiques, tant de l’univers anglo-caribéen dans son ensemble, que de la société singulière de Trinité-et-Tobago. Ce réalisme radical sur le plan des idées s’accompagne d’un certain pragmatisme sur celui de la praxis politique, puisque ses positions et ses décisions découlent d’appréciations déterminées par les conditions concrètes de choix qui se présentent à chaque instant.
Tout cela conduit à un autre point qui illustre la place du matérialisme historique dans la vie et l’œuvre d’Eric Williams : sa vision de la totalité. Dans tous ses travaux historiographiques, il donne à voir des phénomènes économiques, politiques, sociaux et culturels imbriqués et explicités dans leur co-détermination, sans qu’aucune sphère particulière de la vie humaine ne détermine mécaniquement les autres. En d’autres termes, il n’y a dans sa pensée aucun déterminisme. D’autre part, sa perspective totalisante se reflète également dans la tendance à observer les processus historiques par le prisme des structures globales et de la longue durée.
Sa méthode d’analyse se caractérise par une observation attentive de la genèse pluriséculaire des structures sociales contemporaines, en accordant une attention particulière à la dialectique des continuités et des ruptures qui façonnent le processus historique. De cette façon, il peut avancer dans la compréhension de ce qu’est le capitalisme lui-même, reprenant certaines des affirmations de Marx sur la caractère mondial de ce mode de production, l’indissociabilité entre travail libre et salarié, et d’autres formes non-libres d’exploitation du travail (en particulier l’esclavage). De telles réflexions constituent quelques-unes de ses principales contributions au matérialisme historique.
Il convient également de mentionner qu’Eric Williams est un critique virulent des interprétations racialistes et ethnicistes des conflits sociaux, qu’elles soient de droite ou de gauche sur l’échiquier politique. Sensible à des problèmes tels que le racisme et l’inégalité entre les Noirs et les Blancs, il est très incisif dans sa conviction quant à la nature profondément sociale, historique et classiste de ces questions.
Dans le contexte de l’émancipation politique des pays caribéens, sa position a le mérite de servir d’instrument de lutte contre les idées suprémacistes sur lesquelles était fondé le colonialisme britannique. Après 1968, ses idées forment également un contrepoint important aux perspectives fondées exclusivement ou majoritairement sur des critères ethniques (aujourd’hui qualifiées d’identitaires), qui déjà à cette époque commençaient à émerger au sein des forces progressistes. Les notions de liberté, d’émancipation et de justice défendues par Eric Williams sont des étendards qui embrassent l’ensemble des sociétés nationales caribéennes, sans se limiter à une partie des groupes sociaux historiquement exploités.
Si l’œuvre d’Eric Williams n’a, d’abord, qu’un impact limité sur l’historiographie académique du monde anglo-saxon, il en est autrement en Amérique latine et dans les Caraïbes. De plus, à partir des années 1960, ses idées trouvent une résonance particulière dans le contexte des luttes pour l’indépendance en Afrique, en Asie et en Amérique, et des mouvements pour les droits civiques aux États-Unis.
Au Brésil, en particulier, la production écrite d’Eric Williams connaît une grande répercussion. Son influence se manifeste dans les travaux de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) ; dans la sociologie dite pauliste (de Florestan Fernandes, Roger Bastide et Fernando Henrique Cardoso, entre autres) ; et dans l’historiographie marxiste hétérodoxe développée par des chercheurs de l’Université de São Paulo (représenté surtout par Emília Viotti da Costa et Fernando Novais). Les principales contributions de Williams à ces écoles de pensée, ainsi qu’à d’autres, peuvent être résumées d’une part, par sa perspective systémique et structurelle sur le problème de l’esclavage dans la modernité et, d’autre part, dans sa démonstration que « capitalisme » et « esclavage » ne sont pas historiquement des termes contraires, mais deux réalités indissociables.
Commentaire sur l’œuvre
La thèse avec laquelle Eric Williams a obtenu son doctorat en 1938, à Oxford, s’intitule The economic aspect of the abolition of the West Indian slave trade and slavery (1938) [L’aspect économique de l’abolition de la traite négrière et de l’esclavage dans les Indes occidentales]. L’auteur y remet en question les interprétations hégémoniques de son temps, notamment celles qui circulent alors en Angleterre, sur la fin légale de la traite négrière et de l’esclavage dans les Caraïbes britanniques. Son approche s’éloigne des lectures qui se limitaient à observer les aspects politiques et moraux du sujet pour souligner, avant tout, les problèmes économiques liés au phénomène. De manière générale, son argumentation consiste à souligner que l’affaiblissement des rapports socio-économiques esclavagistes dans les Indes occidentales était lié à l’évolution du rôle joué par la région dans le système colonial britannique. Cette évolution découle de plusieurs facteurs : la concurrence outre-mer entre les métropoles anglaise et française, les fluctuations des dynamiques de production, du commerce et de la traite négrière dans les autres colonies caribéennes, les soulèvements d’esclaves de l’époque, et les contradictions croissantes entre les intérêts de la métropole monopoliste et ceux des secteurs de plus en plus puissants des élites coloniales.
Quatre ans plus tard, après un long voyage à travers différents pays des Caraïbes, Williams publie son premier livre : The Negro in the Caribbean [Le Noir dans les Caraïbes] (Washington/États-Unis : The Associates in Negro Fole Education, 1942). Dans ce texte, l’auteur réalise une sorte de description ou de prosopographie sociale du monde caribéen, examinant en détail les héritages néfastes que le passé esclavagiste a laissés aux populations noires de chaque lieu.
Lors de la publication de The Negro in the Carribean, Williams est déjà profondément impliqué dans la production de ce qui allait être l’œuvre la plus importante de sa trajectoire intellectuelle : Capitalism and Slavery [Capitalisme et esclavage] (Caroline du Nord/États-Unis : University of North Carolina Press, 1944). C’est un deuxième produit du même projet de recherche historique plus large qui l’avait guidé dans la production de sa thèse de doctorat. Ce texte comporte des caractéristiques propres d’un essai, étant moins adossé à des références et à des sources historiques primaires, mais est néanmoins plus abouti en termes de cadre théorique et d’approfondissement interprétatif. Passons en revue les principaux éléments présentés par Williams.
La première conclusion de Williams est que l’origine de l’esclavage des Africains en Amérique est principalement liée à la grande disponibilité des terres dans certaines régions du continent, comme les Caraïbes, dont les extensions de terres disponibles pour la production tendent à inviabiliser le salariat, trop coûteux dans ces circonstances, générant ainsi une intense polarisation sociale entre maîtres et esclaves. Cependant, pour que l’esclavage devienne viable en tant qu’institution, un flux régulier de travailleurs captifs doit pouvoir atteindre le Nouveau Monde à travers un réseau stable de traite d’esclaves.
Les établissements commerciaux liés à ce trafic donnent naissance, dans certaines régions d’Angleterre et notamment à Liverpool, à une puissante classe de marchands ayant une hégémonie idéologique et la capacité de s’organiser politiquement pour défendre ses intérêts au sein des principaux espaces institutionnels britanniques, comme le Parlement. Toute éventuelle offensive des opposants à l’esclavage sur des motifs moraux est ainsi rendue plus difficile. Cette classe de marchands britanniques jouit, en général, du soutien de riches familles d’agriculteurs et de marchands des Indes occidentales, qui ont intérêt au maintien de l’ordre colonial et esclavagiste.
Un commerce triangulaire qui relie l’Afrique (source de main-d’œuvre asservie), les Antilles (productrices de sucre) et l’Angleterre (exportatrice de produits manufacturés) se développe à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle et se consolide au milieu du XVIIIe siècle. Le trafic repose sur le principe du monopole commercial, c’est-à-dire sur l’idée que les produits coloniaux ne peuvent être vendus qu’à la métropole ou aux régions soumises à son contrôle. Ce mécanisme donne une grande impulsion au processus d’industrialisation anglais, dans la mesure où les plantations des Caraïbes et la traite des esclaves britanniques ont été les principales sources de capitaux de la révolution industrielle et, par conséquent, du développement du capitalisme anglais.
Le processus d’approvisionnement alimentaire des Indes occidentales dépend alors de la petite et moyenne production de biens de subsistance qui, à cette époque, est réalisée dans les treize colonies nord-américaines (actuel territoire des États-Unis). Le processus d’indépendance des futurs États-Unis, initié en 1776, interrompt la liaison entre les deux régions, précisément pendant la période de plus grande expansion de l’industrialisme anglais. Ces éléments se conjuguent pour peser en faveur de la fin du monopole colonial, mais aussi de la traite d’esclaves et de l’esclavage, gagnant des défenseurs en Angleterre et un soutien populaire croissant.
Lorsque la colonie française de Saint-Domingue devient la principale région productrice de sucre en Amérique (fait qui s’ajoute à la concurrence du sucre brésilien et du coton américain), l’importance des Caraïbes anglaises pour le marché européen diminue. Dans le même temps, dans la colonie, les fermiers blancs, les esclaves et les noirs affranchis intensifient leurs actions contre le système esclavagiste, accélérant ainsi le processus de conquête de la liberté formelle de la main-d’œuvre.
Après la publication de Capitalisme et esclavage, la profonde implication critique d’Eric Williams dans les affaires intérieures de sa macro-région d’origine – à travers la Commission anglo-américaine pour les Caraïbes (quand il enseignait encore à Washington) – débouche sur l’écriture et la publication de l’ouvrage Education in the British West Indies [L’éducation dans les Indes Occidentales] (New York: A & B Books Publisher, 1946), dans lequel il se penche sur la structure organisationnelle de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dans les Caraïbes anglophones, cherchant toujours à retrouver les racines historiques des problèmes qu’il observe dans le présent.
Entre 1964 et 1970, Williams publie une triade d’œuvres qui acquièrent rapidement une reconnaissance nationale, et plus tard internationale, bien qu’aucune d’entre elles n’atteigne le même niveau d’originalité, de pertinence et de répercussion que Capitalisme et esclavage. Le premier, History of the people of Trinidad and Tobago [Histoire du peuple de Trinité-et-Tobago] (New York : Frederick A. Praeger Publisher, 1964), lancée immédiatement après l’émancipation politique, a pour objectif fondamental de sortir l’histoire générale de Trinité-et-Tobago du silence qui lui avait été jusqu’alors imposée par l’hégémonie idéologique des universitaires britanniques, dont l’attention n’était que sporadiquement tournée vers cette ancienne colonie. En outre, l’ouvrage entend contribuer au renforcement d’une identité nationale du peuple trinidadien ancrée dans un passé national commun. Dans l’interprétation historique proposée par Williams, le sujet principal et actif ne se limite pas à quelques personnalités illustres ou supposément géniales. Il se compose plutôt, comme l’indique le titre du livre, du « peuple » dans son ensemble, impliqué de manière complexe dans les structures de domination et d’exploitation qui ont historiquement marqué son passé.
Le deuxième ouvrage de cette période, British Historians and the West Indies [Les historiens britanniques et les Indes Occidentales] (Londres : André Deutsche, 1966), consiste en un effort de l’auteur pour approfondir sa critique de la façon dont les intellectuels britanniques, et en particulier les historiens, ont traité et représenté historiographiquement la partie occidentale de leur Empire, c’est-à-dire l’histoire des anciennes colonies anglaises dans les Caraïbes. Critiquant radicalement l’idéologie impérialiste et colonialiste — hégémoniques dans le milieu universitaire britannique — des approches concernant les Antilles britanniques, Williams démontre qu’un récit historique renouvelé de la région doit encore être produit, en cohérence avec le contexte ouvert par les mouvements d’indépendance, alors récents.
Williams concrétise lui-même ce projet six ans plus tard, dans le troisième et dernier des ouvrages mentionnés, From Columbus to Castro: the History of the Caribbean [De Christophe Colomb à Castro : l’histoire des Caraïbes] (New York : Millésime, 1970). C’est un ouvrage complet qui offre au lecteur un bilan rigoureux des grandes lignes qui ont traversé l’histoire de la Caraïbe au cours des cinq derniers siècles. Dans ce livre, Williams reprend en partie la perspective qui caractérisait, des années auparavant, Capitalisme et esclavage, notamment en ce qui concerne les liens entre la colonisation, le capital, les marchandises et l’esclavage dans la formation historique des Caraïbes.
Tout en préparant From Columbus to Castro, Williams se consacre également à l’écriture de son autobiographie, publiée un an plus tôt sous le titre Inward hunger: the education of a prime minister [Faim intérieure: L’éducation d’un premier ministre] (Londres : Andre Deutsch, 1969).
L’année de sa mort, un recueil de ses discours est édité par Paul K. Sutton – Forged from the love of liberty: selected speeches of dr. Eric Williams [Forgés dans l’amour de la liberté : discours sélectionnés par le Dr. Eric Williams] (Trinité : Longman Caraïbes, 1981) –, un ouvrage qui rassemble des versions transcrites de déclarations politiques et d’autres textes lus publiquement par l’auteur tout au long de sa carrière d’homme d’État.
Une décennie plus tard, Selwyn R. Cudjoe publie le volume Eric E. Williams speaks: essays on colonialism and independence [Eric E. Williams parle : Essais sur le colonialisme et l’Indépendance] (Massachussets : Calaloux Publications, 1993), qui complète la publication précédente avec de nouveaux textes. Outre les discours de Williams, les deux recueils contiennent des études introductives qui approfondissent considérablement la connaissance de divers aspects de la vie et de l’œuvre du penseur.
Pour une liste complète des travaux d’Eric Williams, y compris ses productions imprimées et manuscrites, publiées et inédites, il est possible de consulter le référentiel numérique de la bibliothèque Alma Jordan de la University of the West Indies (archivespace.sta.uwi.edu), où une riche collection documentaire de photographies, de livres, de notes de recherche, de correspondance et d’autres documents appartenant à ou rédigés par Williams est actuellement conservée.
Références
ALONSO, R. A. de M. “Williams, Eric”. Enciclopédia Latinoamericana. São Paulo: Boitempo, 2015. Disp.: https://latinoamericana.wiki.br.
MARQUESE, R. de B. “Capitalismo e escravidão e a historiografia sobre a escravidão negra nas Américas”. Em: WILLIAMS, Eric. Capitalismo e escravidão. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
PALMER, C. A. Eric Williams & the making of the modern Caribbean. Chapel Hill (EUA): University of North Carolina Press, 2006.
SELWYN, R. Eric Williams: the myth and the man. Kingston (Jamaica): University of the West Indies, 2009.
SOLOW, B. L.; ENGERMAN, S. L. (orgs.). British capitalism & Caribbean slavery: the legacy of Eric Williams. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
ST. PIERRE, Maurice. Eric Williams and the anticolonial tradition: the making of a diasporan intellectual. Charlottesville (EUA): University of Virginia Press, 2015.
Notes
* Gustavo Velloso, historien, est professeur à l’Université fédérale de Bahia (UFBA). Il est docteur en histoire sociale (USP/Univ. Sevilla) et coordonne le Groupe de Recherche sur le Travail dans les Amériques (LABORINDIO). Il est l’auteur, entre autres livres, de Ociosos e sedicionários: populações indígenas e os tempos do trabalho nos Campos de Piratininga (Intermeios, 2018) et Os nós da flecha: crise e sublevação na fronteira meridional do império espanhol (USP/US, 2022).
* Article édité par Pedro Rocha Curado, Yuri Martins-Fontes et Felipe Santos Deveza, et originellement publié sur le portail du Núcleo Práxis-USP, en tant que notice du Dictionnaire Marxisme en Amérique, œuvre collective coordonnée par cette organisation. Sa reproduction sans fins commerciales et sans altération est autorisée. La source doit impérativement être citée (nucleopraxisusp.org). Les suggestions et les critiques sont les bienvenues, elles peuvent nous être communiquées à cette adresse : nucleopraxis.usp.br@gmail.com.